Féminimse ?
ça ne veut rien dire, « féminimse ». C’est une faute de frappe ? Non. Non, non. Bah si, ça veut rien dire ! Oui, mais non : c’est fait exprès. Tssk, mais n’importe quoi. Oui, m’imporque toi, si tu veux. … Voilà, à force de les entendre ou de les lire partout, de tout temps, tout terrain et à toutes les sauces, certains mots se cabossent, et on ne sait plus trop bien ce qu’ils veulent dire. Parle-t-on bien de la même chose ? Alors, féminisme, ou féminimse ?
Être ou ne pas être féministe, telle est la question.
Chez les vingtenaires, chez les plus vieux branchés adeptes des évènements de réseautage, on est féministe. Forcément. Il y a dix ans j’avais l’impression que les féministes c’était un peu des super héroïnes, ou des Jean Moulin, le genre de personne exceptionnelle qui se bat pour l’intérêt collectif, avant le sien, qui se sacrifie si besoin, bref, qui ne court pas les rues. Il y a dix ans, je n’entendais personne se présenter en soirée en disant « Salut je suis écoféministe et je déteste les gosses », ou « Nan mais t’as pas lu Sorcières ? Mais WHAT ? » J’avoue que parmi mes secrètes ambitions, il y a être payée dans la mesure de mes compétences et du travail fourni, qu’on arrête de m’appeler « ma grande », et de me dire que je fais « des petites émissions radio », que j’ai « un petit blog ». Oui, je voudrais aussi avoir de jolis vêtements, du chauffage en hiver, et voyager. Je suis pas sûre que ça m’autorise à me dire féministe, et d’ailleurs, je ne me définis pas comme telle.

Les rares fois où j’ai pu être qualifiée de « féministe », c’était plutôt par des hommes vieux et pas contents que je leur tienne tête, ou que je rappelle sans aucune modestie qu’ils parlaient de mon travail. Peut-être voulaient-ils dire « mal-élevée » pour une fille ? J’ai comme l’impression que ce mot n’a pas le même sens pour tout le monde. Il est en effet grand temps de donner aux femmes la place et le respect qu’elles méritent, et je salue celles qui se battent au quotidien et dont on entend rarement parler, comme par exemple les femmes de chambre de l’hôtel Ibis, qui ont lutté pendant 22 mois contre leur employeur.
Sur un malentendu, ça peut marcher
Sur les applis de rencontre, beaucoup de femmes entre 25 et 35 ans indiquent être « féministe », comme dans le monde d’avant on pouvait indiquer « road trip en Australie » ou « photographie argentique », ou encore « modèle amateur ». Donc se dire féministe, ça devient un argument de vente, ou un atout séduction. Dans le doute, j’ai demandé à un ami adepte de ces applis son avis sur la question. Swipe-t-il favorablement quand il voit le mot « féminisme » ? Bah oui, plutôt, oui. Comme c’est un séducteur fou, un tout petit petit peu misogyne, j’ai fait part de ma surprise. Il a souri. J’ai insisté, car je voulais savoir. J’étais déjà assise, avec un double café, donc j’étais prête à tout entendre. Donc : pourquoi ? À mi-voix, en s’assurant que personne ne l’entendait dans le café, surtout pas la jolie serveuse, il a lâché le morceau.
Premièrement : la plupart des nanas « féministes » sont jolies.
Deuxièmement : il imagine que si elles écrivent ça, c’est pour montrer que ce sont des femmes « libérées », donc qu’il espère passer des moments plus amusants au lit qu’avec une prude qui cherche le grand amour.
Troisièmement, une femme qui se proclame « libre de son corps », sans besoin d’attaches et indépendante, ça veut dire pas de SMS casse-pieds, pas d’appels incessants « après », et pas quinze rendez-vous « avant » pour se décider. Finalement, c’est tout ce qu’il cherche.
Sluuuuurp… le café thhheu thh… J’avale de travers. Bon, bon…
Il admet que parfois, il lui arrive de se tromper. La soirée « Cinquante nuances de Grey » qu’il s’était imaginé avec une femme « féministe à mort », tatouée « fuck le patriarcat » sur l’avant-bras, et terriblement sexy, se transformant en soirée croque-tofu maison dans une colocation de femmes artistes qui proposaient une lecture collective de Maya Angelou pour la Fête des voisins. Il s’était exfiltré grâce à son chat épileptique, qui avait besoin de sa présence. Il s’estime avoir été « harcelé » de SMS après pendant 15 jours, dont quelques mots grossiers, que je vous dirais à la sortie. Comme le disait Jean-Claude Dus, « Sur un malentendu, ça peut marcher. » Le féminisme serait-il un malentendu ? Ou une façon de dire la peur de l’engagement et de l’attachement ? Le malentendu viendrait-il de siècles à genrer les comportements ?

Dans mon milieu professionnel, il y a de plus en plus de femmes qui se disent féministes, parfois même des hommes. On voit donc apparaitre des nouveaux mots, « chercheure », et des .e partout. Par contre, l’égalité salariale, qui m’intéresse plus, je l’admets, semble un peu plus lente. Mais maintenant il y a des référents discrimination à qui s’en plaindre.
Et là… Parfois, j’ai du mal à comprendre. Enfin, disons que le décalage entre les propos et les actes dépasse parfois ma comprenette. Un exemple. Une femme engagée dans un dispositif de mentorat féminin, qui se définit comme féministe. Nous faisons ensemble une émission où il est question de sororité, d’empowerment, de soft power, etc. Bon moment. C’est une personne que j’ai dû croiser deux ou trois fois sur des festivals, et que je ne connais pas, mais qui semble intéressante.
Quelques temps plus tard, des amis me rapportent qu’elle « bitche » derrière mon dos, raconte n’importe quoi sur moi. Je lui ai donc demandé d’arrêter de raconter n’importe quoi sur les gens qu’elle ne connaît pas, que je me tiens à sa disposition si elle veut en savoir plus sur moi et parler des rumeurs qu’elle propage, et que je la remercie de cette belle émission autour de la sororité. Réponse hautaine et agressive, avec un « ma grande », elle estime que je la menace et que je suis vénère, alors que je ne fais que l’interroger sur le décalage entre la sororité publique, et le fait de dénigrer une autre femme, qu’on ne connait pas, dans son dos, dans son réseau pro, sans aucun argument valable – elle estime que je ne lui souris pas assez. Aucune excuse.
Elle a ensuite envoyé des messages agressifs aux amis qui m’ont rapporté ses propos. Pour moi c’est déconcertant. J’ai tendance à croire qu’une femme qui se lâche comme ça sur une autre femme fait tout pour rassurer les tenants de l’ordre établi. En avant les clichés : les femmes ne savent pas se tenir, elles crient et réfléchissent après, elles font toujours des histoires, elles ne s’entendent et ne se respectent même pas entre elles ! Comment pourrait-on faire confiance à ces faiseuses d’histoires ? Comment pourrait-on confier des responsabilités à ces braillardes ?
Et aussi, que se joue-t-il quand une femme bave derrière le dos d’une autre, notamment auprès d’une assistance masculine ? Peut-être ces derniers vont-ils implicitement entendre une demande d’aide, une demande de sanctionner, d’exclure une autre femme, et c’est donc leur conférer le pouvoir de le faire. « Que feraient-elles sans nous ? » Par ailleurs, cela peut aussi être une façon implicite de se positionner comme une « bonne femme », face à celle qui serait une « mauvaise femme », entre autre parce qu’elle ne serait pas assez aimable, souriante, bref, dans ce rôle d’hôtesse d’accueil un peu potiche qui fait la joie des petits et des grands.

Cette personne a ensuite reconnu que j’étais très compétente.
Donc
Je
comprends
encore
moins
Pourquoi ce n’est pas ça qu’elle dit derrière mon dos ? Qu’est-ce qui est vraiment important ? Être efficace, compétente, et comme n’importe quel être humain, ne pas afficher un sourire béat H24 ? Ou alors être gentille, polie, souriante, et accessoirement compétente et douée ? Si je devais recruter, je sais à quelles qualités je donnerais la préférence.
The Harvard Gazette – Ulrich explains that well-behaved women should make history
« J’aime leur petite chanson, même s’ils passent pour des cons »
À ce stade, une nouvelle interrogation m’effleure : et si c’était moi qui pensais « comme un homme » ? Ou qui me comportais « comme un homme » ? Mais non, ça ne convient pas non plus : « comme un homme », ça ne veut rien dire. Je sens en tout cas que ma façon de penser les choses, sans être meilleure qu’une autre, évidemment, n’est partagée que par peu de monde dans mon entourage. Aussi, par paresse, par envie de tranquillité, peut-être aussi par lâcheté, je m’applique de plus en plus à éviter toute discussion de vive-voix sur ces sujets, parce que s’interroger en la matière est souvent très mal perçu, vécu comme une attaque personnelle, comme si la capacité à la nuance, à l’argumentation, au débat se perdait de plus en plus. On a raison ou on a tord, on est « avec » ou on est « contre ». Questionner l’affirmation de soi de l’autre n’est pas perçu comme une envie de le comprendre, de créer un lien avec lui, mais comme une agression, une remise en question, tout autant que de se montrer totalement indifférent aux étiquettes dont l’autre se pare sous vos yeux. Et personne n’y échappe. Je ne dis pas autre chose, quand je souhaite voir reconnue mon étiquette « compétente ». Comme je ne sais pas comment finir ce billet, je vous propose cette magnifique chanson de Anne Sylvestre. Car moi aussi, j’aime les gens qui doutent.









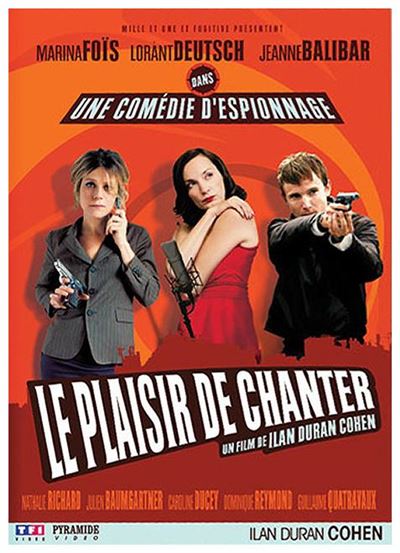










 « No man is an island entire of itself ; every man is a piece of the continent, a part of the main » John Donne
« No man is an island entire of itself ; every man is a piece of the continent, a part of the main » John Donne